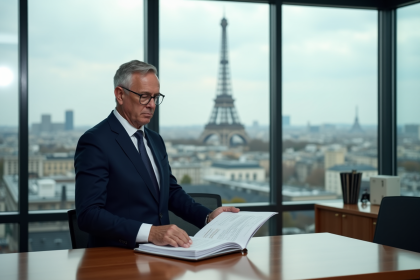Le pourcentage d’États ayant ratifié les grands textes relatifs aux droits de l’homme tutoie les sommets. Pourtant, l’Arabie saoudite, l’Iran ou la Chine restent à l’écart de traités internationaux qui façonnent les libertés individuelles à l’échelle planétaire. Malgré le mythe d’un consensus global autour de la Déclaration universelle des droits de l’homme, certains pays s’écartent résolument, pour des raisons politiques, religieuses ou historiques, des principes définis en 1948.
Ce positionnement assumé ou cette absence de signature maintiennent ces États à l’écart du socle commun, relançant le débat sur la force réelle des engagements internationaux en matière de libertés. Les conséquences, tant sur le plan juridique que diplomatique, restent un sujet brûlant au cœur des relations internationales.
Comprendre la Déclaration universelle des droits de l’homme : genèse, principes et portée
Le 10 décembre 1948, Paris devient l’épicentre d’un espoir inédit : l’Organisation des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce texte, fruit d’un compromis fragile après les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, doit beaucoup à l’engagement d’Eleanor Roosevelt et à la rigueur de René Cassin. Deux ans à peine auront suffi pour poser noir sur blanc la reconnaissance de la dignité humaine et des libertés de chacun, sans distinction d’origine, de croyance ou de condition.
S’appuyant sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration élargit le champ des libertés et crée un socle en deux volets, qui structure encore aujourd’hui la protection des droits :
- Droits civils et politiques : liberté d’expression, vie privée, égalité devant la loi, droit à la sûreté
- Droits sociaux, économiques et culturels : accès à l’éducation, droit au travail, à la protection sociale
Si la Déclaration universelle ne crée pas d’obligations juridiques immédiates, elle inspire la rédaction d’accords majeurs comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La France, actrice de premier plan, imprime sa marque à ce projet collectif, faisant de Paris le centre nerveux, l’espace d’un instant, des Droits humains universels.
L’impact de ce texte dépasse le strict cadre du droit : il façonne les constitutions, irrigue la jurisprudence et trace la ligne de conduite de multiples instances internationales. Son universalité continue de susciter des débats, mais son influence demeure, même là où la résistance des États membres se fait sentir.
Pourquoi certains pays n’ont-ils pas signé ou ratifié la Déclaration ?
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’a jamais imposé la signature à l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations Unies. Dès 1948, quelques pays ont préféré s’abstenir, d’autres ont marqué leur désaccord, et le vote n’a pas fait l’unanimité. L’Ukraine et le Honduras, par exemple, n’étaient pas présents lors de la signature de certains pactes ou conventions complémentaires, sans pour autant tourner le dos à la Déclaration elle-même.
Plusieurs motifs sous-tendent ces refus ou abstentions. Premier frein : la défense de la souveraineté nationale. Pour certains dirigeants, ratifier un texte international relatif aux Droits humains revient à accepter qu’une norme extérieure puisse supplanter leur Constitution, ou remettre en cause leur propre ordre juridique. La peur de voir la politique nationale dictée depuis l’étranger reste vive.
Les régimes autoritaires, eux, craignent l’effet boomerang d’une telle adhésion. Reconnaître ces droits, c’est potentiellement ouvrir une brèche aux contestations internes, fragiliser le pouvoir central. Parfois, l’argument des traditions locales, des valeurs religieuses ou d’un modèle politique singulier sert de rempart. Pour une partie du globe, la notion de Liberté reste associée à un modèle occidental, perçue comme un levier d’influence ou d’ingérence.
Enfin, la question de l’application concrète est posée. Ratifier la Déclaration universelle implique-t-il vraiment de modifier le quotidien des citoyens ? En l’absence d’obligation juridique ferme, plusieurs Pays choisissent de rester fidèles à leur propre vision des responsabilités de l’État, sans s’aligner sur des standards globaux.
Conséquences concrètes : quels impacts pour les populations concernées ?
Quand un État ne ratifie pas une Convention européenne des droits de l’homme ou toute convention internationale similaire, ce sont des millions de personnes qui se retrouvent privées de recours. Sans accès à la Cour européenne des droits de l’homme ou à une jurisprudence internationale solide, toute violation des Droits fondamentaux se heurte à une quasi-impasse. Les procédures de plainte, les mécanismes de contrôle, les possibilités d’appel vers l’international s’effacent. La société civile se retrouve isolée, privée de relais comme le Conseil de l’Europe.
Au-delà des subtilités juridiques, c’est l’exercice même des Droits civils et politiques qui s’en trouve affecté : liberté d’expression, procès équitable, respect de la vie privée. Sans rattachement à des textes comme la Convention de Rome ou la Charte de New York, toute protection ne dépend plus que de la Constitution nationale. Un équilibre précaire, exposé aux changements de cap politiques.
Dans certains États, l’absence de référence à une Convention européenne prive les minorités des garde-fous qui font la différence ailleurs. À l’inverse, un pays comme le Canada ou ceux d’Europe occidentale permettent à chaque citoyen de saisir une juridiction supranationale. Ce droit d’appel, inexistant dans d’autres contextes, transforme radicalement la donne en matière de protection des droits individuels.
Voici quelques conséquences directes de cette situation :
- Accès limité à la justice internationale
- Droits sociaux et culturels fragilisés
- Dépendance accrue à l’égard du contexte politique national
Défendre les droits humains aujourd’hui face aux résistances et aux nouveaux défis
Des organisations telles qu’Amnesty International ou la Commission Droits de l’Homme multiplient les signalements. Les Libertés fondamentales sont bousculées par la montée des régimes autoritaires, les technologies de surveillance de masse et la tentation du repli. À l’Organisation des Nations Unies, les héritages de la Magna Carta ou de la déclaration de Thomas Jefferson servent toujours de boussole, mais la route reste longue.
Désormais, la défense des Droits humains passe par la résistance à des stratégies de contournement de plus en plus élaborées. Certains États verrouillent la société civile, d’autres contestent la légitimité des instances internationales. De Mary Robinson à Paulo Sérgio Pinheiro, des figures indépendantes insistent sur la nécessité de préserver un espace public ouvert et pluraliste.
Les défis se multiplient : criminalisation des voix dissidentes, contrôle du numérique, attaques contre la presse. Pour y faire face, l’action collective se réinvente. Les réseaux transnationaux, l’ancrage local et les nouvelles technologies dessinent des voies inédites pour défendre les droits.
Voici deux aspects majeurs de ce combat contemporain :
- Respect des droits homme et libertés : un équilibre toujours fragile, sans cesse remis en cause.
- Coalitions transnationales : vigilance et engagement de tous les instants, nécessaires pour peser sur la durée.
L’UNESCO continue d’affirmer le lien indissociable entre droits humains, éducation et paix. Les défis changent de visage, mais la quête de dignité, elle, avance sans jamais baisser la garde. Qui osera dire où s’arrêtera ce combat ?